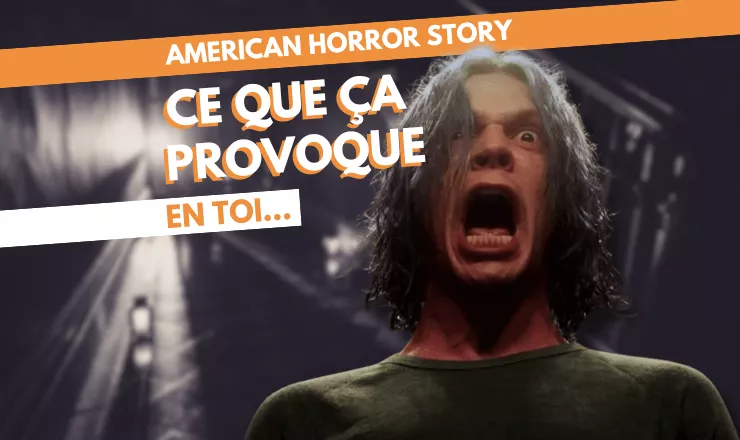Découvrez aussi...
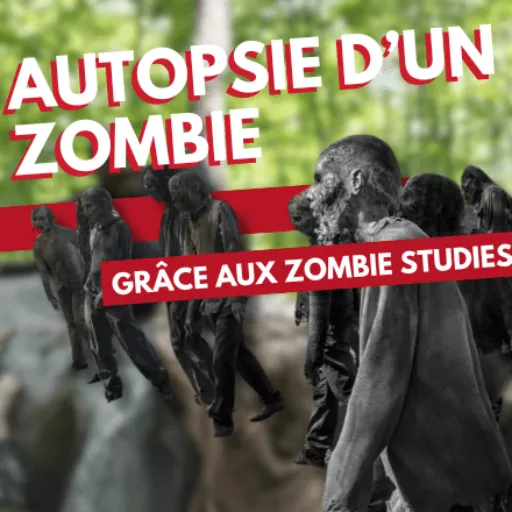
Vivant, Santé
Autopsie d’un zombie
Et si on se plongeait dans la tête d'un zombie ? Pas littéralement hein... On va prendre le zombie comme objet d'étude !
Il y a 1 an

Vivant, Santé
Les secrets de l’hypnose
L'hypnose fait partie de ce qu'on appelle en science, les états modifiés de conscience et elle en est un cas particulier !
Il y a 1 an
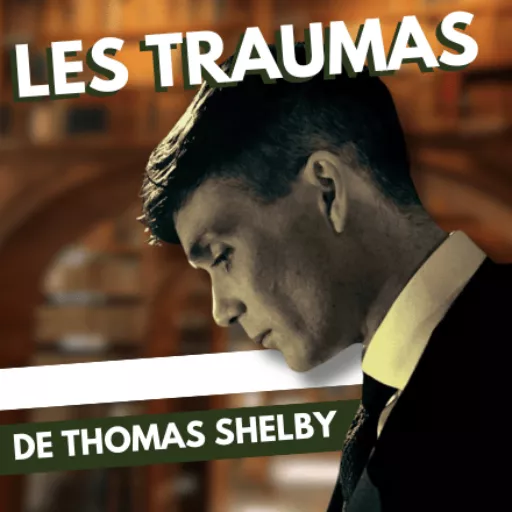
Histoire, Géographie, Société
Les traumatismes de Thomas Shelby dans Peaky Blinders
Derrière le charisme redoutable de Thomas Shelby se cache un cerveau un peu différent…
Il y a 11 mois